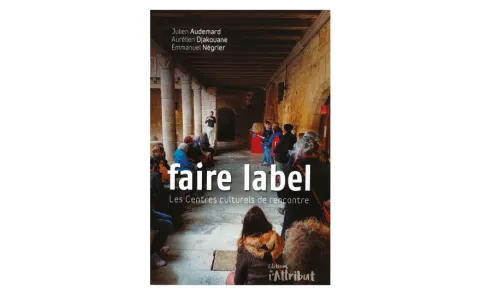
Julien Audemard, Aurélien Djakouane, Emmanuel Négrier
Le réseau des centres culturels de rencontre a plus de 50 ans. Il reste, pour une part, méconnu des acteurs culturels, alors qu’il pose depuis sa création les bases d’une rencontre entre le patrimoine et les arts visuels et vivants. Fort de 23 lieux en France, et de quelques autres à l’étranger, où ce concept a essaimé, il constitue un intéressant creuset de création, aujourd’hui ouvert aux industries culturelles, qui en font un réseau de pointe en matière d’innovation et d’hybridité artistiques. Parmi ceux-ci, certains sont porteurs de projets forts, connectés au champ du spectacle vivant, tels que la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon (Gard) l’Abbaye de Noirlac (Cher), l’ARIA (Haute-Corse), Le Plus petit cirque du monde (Hauts-de-Seine), l’Abbaye et Fondation de Royaumont (Oise), la Maison Maria-Casarès (Charente)… S’il est trop peu connu, c’est sans doute pour sa très grande hétérogénéité. Chaque projet y est singulier, en écho à un patrimoine et à son territoire. Les chercheurs Julien Audemard, Aurélien Djakouane et Emmanuel Négrier nous apportent ici des clés de compréhension pour mieux appréhender le réseau des centres culturels de rencontres. Ils analysent ensemble leurs activités, mais aussi leurs modèles économiques et leur gouvernance. Ils présentent aussi la nature et la qualité des partenariats à l’œuvre. En fin d’ouvrage, chacun des 23 sites bénéficie d’une fiche de présentation qui permet d’identifier les axes de son projet. Si, aujourd’hui, le dialogue entre le patrimoine et les arts vivants est parfaitement compris, intégré, par les politiques publiques, confirmant l’intuition de départ, celle des années 1970, il n’en reste pas moins que « la reconnaissance publique, collective comme propre à chaque centre, se révèle très inégale selon les territoires et les institutions partenaires, sans que l’intervention de l’état soit en mesure de pallier une telle inégalité ». À travers cet ouvrage, on traverse une histoire des politiques culturelles, du processus de labellisation à celui de la déconcentration, en passant par l’enjeu de l’internationalisation. Le réseau est méconnu, mais d’importance. En 2023, il pesait pour 80 millions d’euros dans l’économie de la culture.
Éditions de l’Attribut, 228 pages, 17,50 euros.
